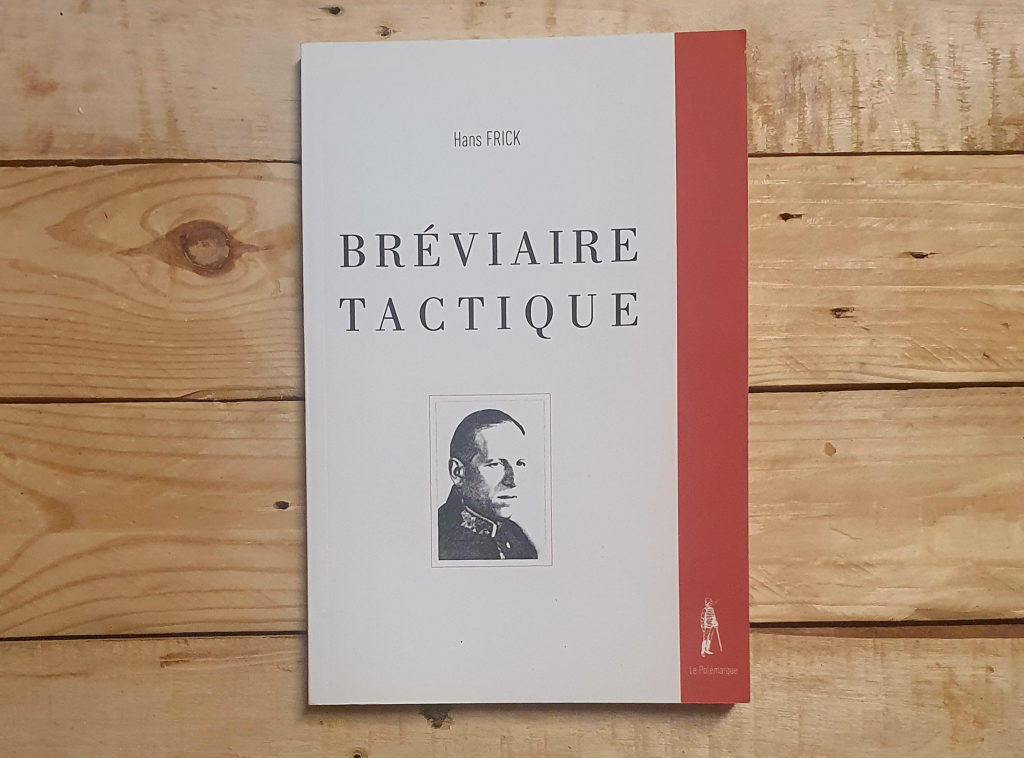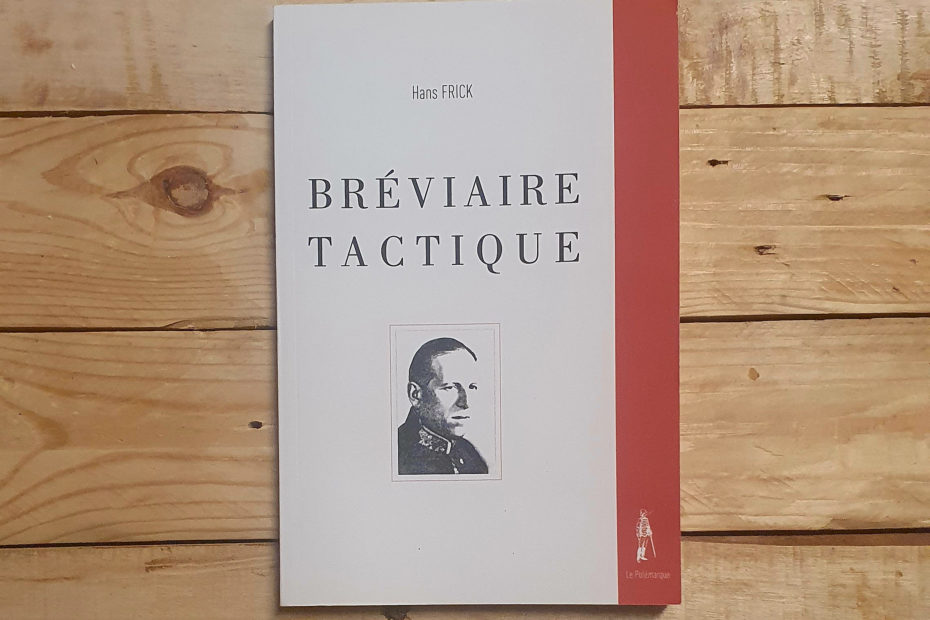Publié avec l’aimable autorisation du lt-col Alain Baeriswyl
L’art de la tactique – ordonner ses moyens dans le temps et dans l’espace.
Combien de fois n’ai-je pas été désespéré de voir que bien de mes collègues ne partageaient pas ma passion de la tactique, de l’étude des « coups tordus », de l’emploi du miroir aux alouettes, du coup de dé, voire du culot le plus absolu (l’importance de la maxime « toujours tricher, toujours gagner »)?
C’est peut-être que la tentation de la « check-list » à l’américaine et de la pensée Power point, que l’étude fiévreuse des mimiques du commandant de la grande unité lors des cours tactiques semblent offrir un chemin plus facile à la conformité ambiante…
Les effets pervers de la mode US sont que non seulement nous utilisons majoritairement leur matériel mais, comme par mimétisme, nous en sommes venus à adopter leur mode de pensée voire leur vocabulaire; ceci explique que l’on privilégie aujourd’hui de plus en plus le recours à la puissance de feu et à la technologie plutôt qu’à l’ingéniosité tactique – l’exemple de la redécouverte de la COIN par Petraeus est particulièrement significatif de cet état d’esprit. Il existe heureusement de salutaires exceptions. « A question of command », de Marc Moyar (Yale Library of Military History, 2011) remet notamment l’église au milieu du village et liste un certain nombre de qualités indispensables à tout chef qui se respecte, (initiative, flexibilité, créativité, bon sens, empathie, charisme, sociabilité, dévouement, honnêteté, organisation)
Le « bréviaire tactique », dans sa version allemande, aura été pour moi un compagnon de tous les instants dès mon école d’officiers, voici un quart de siècle. C’est que, comme le disait si bien Georges Brassens, « Sans méthode, le talent n’est qu’une sale manie… »
Bien que traditionnellement on ne parle de tactique qu’à partir de l’échelon compagnie, il est souhaitable que les cadres de l’unité disposent d’une instruction élémentaire dans ce domaine. Il s’agit avant tout d’éveiller l’intérêt des jeunes cadres pour la tactique, et de les encourager à réfléchir à la manière d’engager leurs moyens dans le temps et dans l’espace, de la manière la plus avantageuse pour nous.
La décision aux petits échelons consiste surtout à décider si l’élément doit tenir son emplacement, avancer, se replier ou esquiver. L’analyse des groupes de facteurs (Mission, milieu, adversaire, propres troupes, temps), les ordres permanents / préalables, les règles d’engagement et de comportement peuvent raccourcir la boucle de décision. Si l’élément est en mode réactif, il faudra fréquemment recourir à une technique d’action immédiate pour reprendre le temps et la distance nécessaire à une décision. Si par contre il a l’initiative, il sera en mesure de gagner la supériorité, respectivement de créer les conditions favorables à l’engagement des moyens de l’échelon immédiatement supérieur.
Dès l’échelon section, il est possible d’injecter un peu de finesse, de « maskirovka », la déception chère à nos amis russes, pour feindre ce que l’on est pas. Opposer une faible défense suivie d’une débandade pour attirer l’adversaire dans une zone de destruction. Simuler une attaque avec le gros, en abusant du « son et lumière », tout en infiltrant de petits éléments mobiles sur les flancs et l’arrière de l’adversaire, laisser certaines armes et éléments « silencieux » dans la première phase du combat pour les dévoiler au moment décisif, faire mouvement dans un terrain réputé impassable, quitte à utiliser la moitié de ses moyens comme sherpas, pour surprendre…
En fait, il y a trois facteurs principaux de succès à l’échelon tactique : sûreté, vitesse, surprise.
La sûreté consiste à garantir sa propre sécurité en tout temps et en tout lieu, éviter d’être surpris… Elle s’obtient par la recherche et l’exploitation de renseignements-clé (facteurs de décision), par la préparation permanente de solutions de rechange (notion de plan A, plan B), et par la dissimulation de ses intentions jusqu’au dernier moment (camouflage, déception, ruses, maintien du secret).
La vitesse. Ce n’est pas tant la vitesse qui importe, mais le rythme… Si le chef a un coup d’avance, il commence la phase suivante avant que l’adversaire ne le réalise. Rapidité dans la préparation de l’action et fluidité dans son exécution. Réorganisation immédiate après celle-ci. La vitesse de préparation des missions s’obtient par une instruction rigoureuse et réaliste, et un contrôle des six savoir-faire individuels (en particulier la notion de « être prêt »). La vitesse d’exécution et de réorganisation est une conséquence directe.
La surprise aux petits échelons est obtenue en jouant sur le moment d’exécution des savoir-faire collectifs, sur l’emplacement d’exécution (travailler sur les flancs et l’arrière de l’adversaire, là où il ne s’y attend pas), et les moyens mis en œuvre (utilisation particulière des armes / brutalité de mise en œuvre). Réaliser l’action alors que l’adversaire ne s’y attend pas, qu’il est occupé à autre chose ou qu’il n’est pas préparé permet diversion et déception… La surprise, par essence, ne dure que quelques secondes. Elle sert, en déstabilisant l’adversaire, à reprendre l’avantage sur lui. En la répétant, et changeant les moyens, le temps, le lieu, on maintient l’adversaire sous pression. C’est avant tout une affaire de méthode…
S’agissant de la méthode, Le « Frick », comme j’ai coutume de l’appeler, amène un complément indispensable à la lecture des mémoires et des souvenirs des grands tacticiens parce qu’il synthétise le savoir tactique en de courtes maximes, il lui donne une rigueur, en permet l’utilisation sur le terrain, il évite l’écueil de l’énumération casuistique. A ma connaissance, une telle synthèse n’a pas été renouvelée depuis en langue française. A cet égard, l’ouvrage de Yakovlev représente sans doute le panorama le plus riche et le plus fouillé à ce jour mais demeure, comme son titre l’indique, une étude « théorique » …
Le Frick permet de systématiser l’expérience des grands tacticiens. A titre d’exemple, je commencerai par Giap et ses préparations méticuleuses et obstinées de l’espace de bataille, en particulier à Dien-Bien-Phû. J’aimerais citer également Kesselring pour son coup d’oeil et son exploitation des faiblesses adverses en conditions difficiles. L’erreur des Alliés, trop prudents à Anzio, a été exploitée sans merci. Il y a évidemment Patton pour sa vaste connaissance historique et son sens du timing. N’oublions pas non plus Bigeard comme brillant commandant de bataillon, menant toutes ses sections sur le même réseau radio, prenant soin de se fortifier à chaque bivouac, d’organiser son plan de feu et d’exercer les contre-attaques. Joukov et sa froide détermination, aux lendemains de Koursk et jusqu’à la poussée sur Berlin. Il y a aussi les obscurs, tel David Donovan, jeune officier des bérets verts au Vietnam et son « Once a Warrior King », dans lequel il devient, comme ses prédécesseurs français du Groupement des Commandos Mixtes Aéroportés, le « viet des viets » par sa connaissance du milieu et son identification à la mission… .
Last but not least, De Lattre de Tassigny en particulier sa campagne du Tonkin dans laquelle l’habileté tactique se conjugue avec l’art politique : abandonner le terrain pour retrouver sa liberté d’action, renverser ainsi la charge de contrôle du territoire en obligeant l’adversaire à se protéger des contre-maquis, fixer dans une guerre sans front un ennemi pourtant particulièrement fluide et insaisissable, savoir profiter de ses atouts « Dites-moi où aller pour que le Viet y vienne aussi et que je le casse ».
Si l’expérience résulte de la comparaison de souvenirs à une doctrine, alors le bréviaire présente de manière magistrale cette doctrine. Au passage je ne résiste d’ailleurs pas à la tentation de rappeler ici les ouvrages que je conseille suivant le niveau tactique: pour le chef de section : « Platoon Leader: A Memoir of Command in Combat James R. McDonough », ou les tribulations d’un chef de section engagé à la pacification d’un village et de ses environs pendant la guerre du Vietnam; à l’échelon au-dessus « Commandant de compagnie » de Charles B. MacDonald, narrant sa campagne de l’automne 1944 au printemps 1945, des Ardennes à l’Allemagne. Pour le commandant de bataillon, encore une fois « Bataillon Bigeard », évoqué plus haut.
Cela peut passer pour un boutade …. et pourtant c’est la réalité du métier de soldat: il faut savoir lire – écrire – tirer. A l’heure actuelle, alors que nos certitudes volent en éclat,que nous devons réviser la plupart de nos repères et des nos références, que notre environnement géopolitique européen et méditerranéen est au bord du chaos, que nos sociétés se délitent, qu’une violence anarchique surgit un peu partout et que nous entrons probablement dans la longue nuit du nouveau Moyen Age, ces trois verbes – lire/écrire/tirer – ont encore plus d’importance qu’auparavant non seulement pour le militaire mais aussi pour tout citoyen soucieux de sa propre sécurité …..
Revenons à Frick… D’aucuns reprocheront à cet ouvrage son orientation exclusivement portée sur la « guerre classique ». Au contraire, je pense que les principes exposés sont intemporels, et s’appliquent sans restriction aux contexte de la guerre irrégulière. Ses quelques paragraphes cristallins sur l’embuscade, dont il relève l’essentiel en quelques mots, sont irremplaçables.
Les traces du Divisionnaire Frick sont encore perceptibles aujourd’hui dans notre publication « Conduite tactique », par son approche rigoureuse et sa recherche de l’essentiel. Par contre, il semble que ses commentaires acides sur les chefs qui cèdent à la tentation du micro-management aient été quelque peu oubliés.
Dans la série du « back to basics », je considère que ce petit ouvrage est une lecture indispensable aux chefs de tous grades, et remercie Laurent Schang d’avoir fait acte de salubrité publique en le publiant à nouveau.
Lt-Colonel Alain Baeriswyl